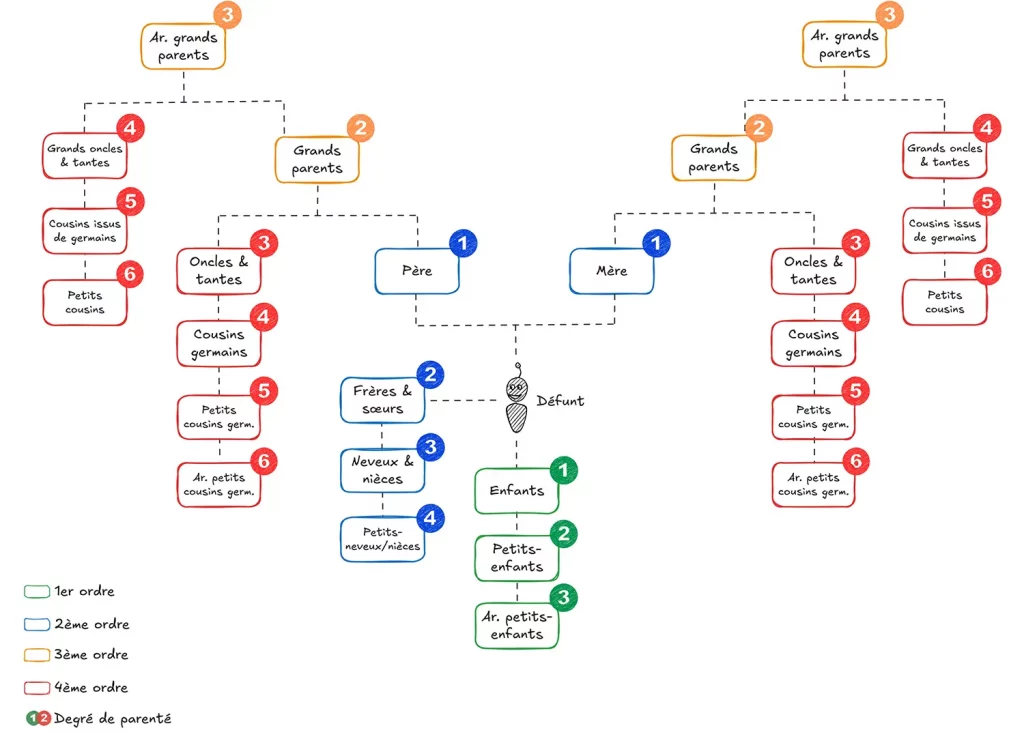🥨 Le saviez-vous ?
Entre 1871 et 1918, l’Alsace-Moselle était sous administration allemande, et le droit local en vigueur à l’époque prévoyait… un régime successoral un peu différent !
Les héritiers ne recevaient pas forcément une part du bien, mais une part en argent (appelée Pflichtteil).
Depuis la loi du 1er juin 1924, tout cela a disparu : le Code civil français s’applique intégralement à la succession en Alsace-Moselle.
Les seules spécificités locales restantes concernent aujourd’hui les associations, les cultes et la protection sociale.
Un petit clin d’œil à notre histoire juridique, qui rappelle qu’en Alsace, on aime conjuguer tradition et modernité… même en matière d’héritage !